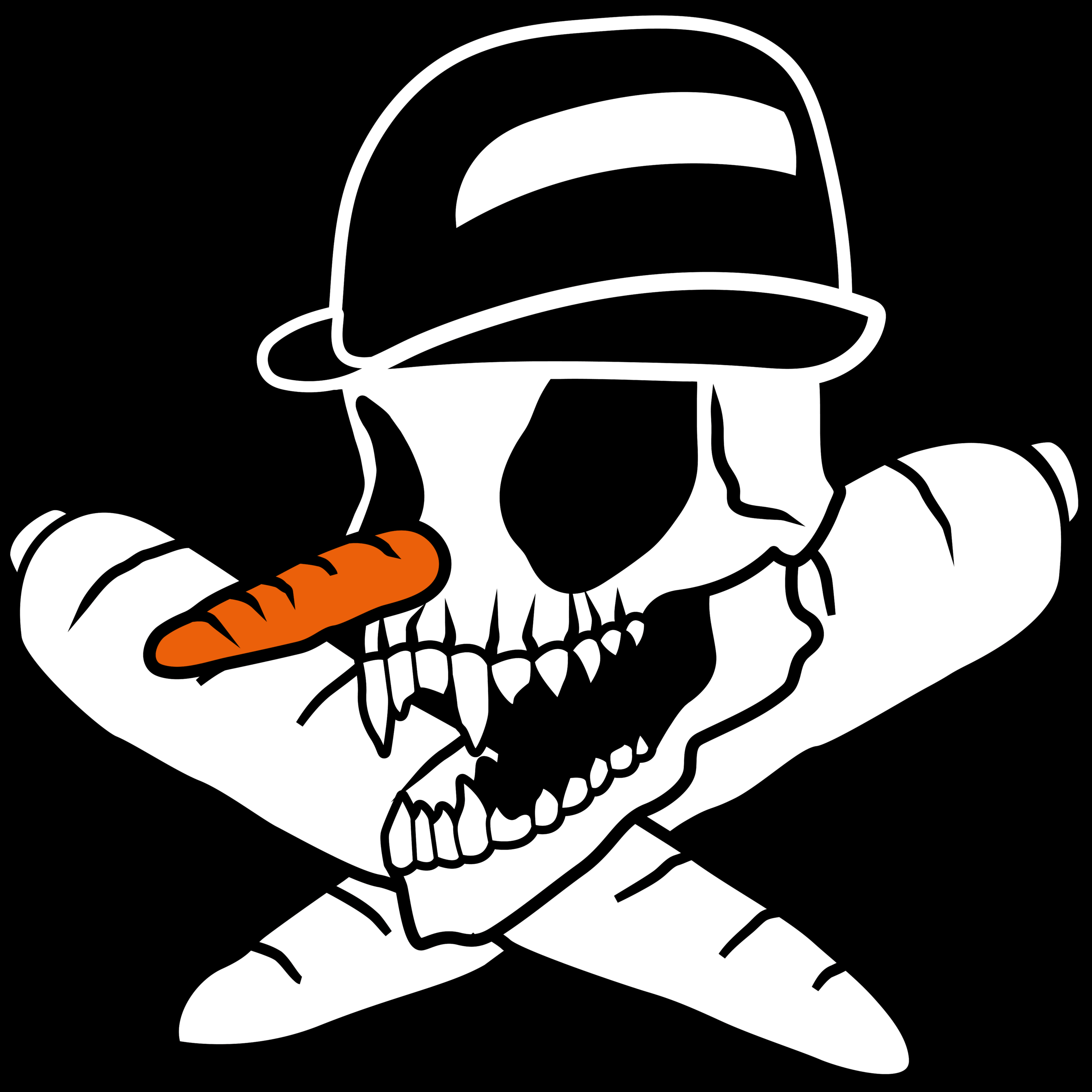
Carnaval d'Evolène
ça ne s'explique pas, ça se vit !
Les Peluches – Lè Patôyè
Parmi ces personnages, les premiers à sortir, dès le lendemain du Réveil du Carnaval et jusqu’à la fin du Carnaval, sont les Peluches ou « Patôyes »[1] en patois.
[1] Origine du terme : “pelisse – Manteau orné ou doublé d’une peau garnie de ses poils.”, Quinodoz Jean, Le Carnaval des chats à Évolène, 13 étoiles : reflets du Valais; 1977, nr. 1, (p.1,10-13)
 Elles portent des masques sculptés à la main dans du bois d’arolle, souvent peints, représentant traditionnellement des têtes de chats, de renards ou de loups. On les appelle des visagères.
Elles portent des masques sculptés à la main dans du bois d’arolle, souvent peints, représentant traditionnellement des têtes de chats, de renards ou de loups. On les appelle des visagères.
Les masques évoluant
avec ceux qui les portent, on trouve aujourd’hui des figures d’animaux provenant du monde entier mais également des monstres sortis de films d’horreur ou imaginés par ceux qui les portent.
Leur corps est habillé d’un complet de peaux non tannées de mouton, de bouc, de chamois, de renard ou de marmotte cousues sur un solide veston par ceux qui vont les porter. Le tout peut peser une bonne quinzaine de kilos.
A l’époque, ces complets étaient bien moins gros et moins lourd. On n’y trouvait que très rarement des peaux de moutons car les Evolènards les utilisaient pour en faire de la laine.
Afin de faire un maximum de bruit, elles secouent sans relâche une cloche de vache, appellée sonnette.
Autrefois, les sonnettes étaient trop précieuses pour la plupart des paysans qui préféraient les garder pour leur bétail. Les peluches portaient donc en bandoulière une cargaison de boîtes de fer-blanc rouillées qui s’entrechoquaient et provoquaient un inquiétant vacarme.
Des masques effrayants, une odeur repoussante et un bruit assourdissant, il n’en fallait pas plus pour effrayer et chasser les mauvais esprits de l’hiver qu’on croyait responsables des avalanches, du froid, des maladies et des mauvaises récoltes.
Avec les peluches, c’est la force sauvage de la nature qui est représentée et utilisée pour les faire fuir.